Eté 1975: Les Dents de la mer connaissent un succès monstre. Et font naître un nouveau modèle économique hollywoodien. Illustration, quarante ans après, avec Terminator: Genisys, qui débarque sur les écrans.
Steven Spielberg vient de prendre un cachet de Valium. Ce 26 mars 1975, après un tournage cauchemardesque et de considérables dépassements de budget, le réalisateur assiste, fébrile, à la projection test des Dents de la mer. A peine la séquence d’ouverture terminée, dans laquelle une jeune femme est dévorée par un requin, un homme se précipite hors de la salle.
Le jeune cinéaste de 28 ans pense que sa carrière est à l’eau. Il décide de s’en aller et retrouve le spectateur dans le hall en train de vomir sur la moquette, faute d’avoir pu atteindre les toilettes à temps, avant de retourner en courant à son fauteuil. Spielberg reprend confiance. Presque deux heures plus tard, un tonnerre d’applaudissements le rassure définitivement. Ce plébiscite pousse les responsables du studio Universal à repenser leur stratégie de distribution. Cette nuit-là, la face du monde hollywoodien va être changée.
Jusqu’alors, un film d’envergure sortait d’abord dans les grandes villes américaines, puis les moyennes et enfin les petites – le tout sur une année, et forcément en évitant l’été, réservé aux fonds de tiroir ou aux nanars. Changement de braquet pour Les Dents de la mer. Le film, dont la sortie est programmée le 20 juin 1975, est à l’affiche dans 675 cinémas à travers les Etats-Unis.
>> Peter Bogdanovich: « Depuis Les Dents de la mer, c’est la course aux blockbusters »
En douze semaines, il engrange 124 millions de dollars. Un record à l’époque. Les recettes sont intégralement reversées à Universal qui, conscient de la demande et soucieux de récupérer les 8 millions de dollars investis, n’a concédé une copie qu’aux exploitants acceptant de se payer uniquement sur les ventes de boissons et de confiseries. Ainsi naît le film popcorn, le blockbuster estival et la franchise hollywoodienne – Les Dents de la mer ont connu trois (déplorables) suites.
« C’est comme la politique, il faut respecter la demande du public »
Quarante ans plus tard. Arnold Schwarzenegger est de passage à Paris, où il présente Terminator : Genisys, cinquième volet de la saga inaugurée par James Cameron en 1984. L’ex-gouverneur de Californie est ravi de retrouver son rôle de cyborg venu du futur pour sauver l’humanité d’un avenir apocalyptique. Il vante les effets spéciaux (impressionnants, il est vrai), loue le scénario qui n’est pas une suite mais un « reboot » (redémarrage de l’histoire qui prend une direction différente) et se gondole déjà à l’idée de tourner un ou deux épisodes supplémentaires.

« Le show-business, explique-t-il, c’est comme la politique, il faut respecter la demande et l’attente du public. Lancer un blockbuster qui n’est pas une suite, c’est comme créer une nouvelle marque, c’est très risqué et beaucoup plus périlleux que de financer Batman 16 ou Superman 24. » Le discours est totalement décomplexé. Et le propos n’a rien de cynique. Il s’inscrit dans une logique industrielle établie plus ou moins volontairement par des artistes comme Francis Ford Coppola (Le Parrain 1, 2 et 3), Steven Spielberg et George Lucas (la saga Star Wars), trois des têtes d’affiche du Nouvel Hollywood.
Pour Jean-Baptiste Thoret, journaliste et spécialiste de la question (Le Cinéma américain des années 70, éd. Les Cahiers du cinéma), « le blockbuster a été créé par des gens qui le conspuaient! Car l’essentiel du cinéma hollywoodien, tel qu’on le connaît aujourd’hui à travers ces ténèbres artistiques qu’il traverse, se met en place lors de son dernier âge d’or, au début des années 1970, quand il existe encore un équilibre entre une logique de divertissement pour le public et l’affirmation auteuriste d’un cinéaste ».
Quatre Arme fatale, cinq Die Hard, douze Star Trek…
Si Coppola, dont Le Parrain explose le box-office et récolte trois oscars, dont celui du meilleur film, se révèle un piètre businessman, Spielberg et Lucas s’adaptent très vite aux lois du marché. Dès le 28 juin 1975, Steven Spielberg avoue au New York Post : « Les Dents de la mer n’est un film catastrophe que s’il ne rapporte pas d’argent. » Universal le comprend bien, qui investit massivement dans des spots télévisés – une première pour un studio. L’effet est dévastateur pour la critique, qui n’a plus aucun poids, et pour les petits films, dévorés par une concurrence cannibale.
De son côté, George Lucas crée en 1977 l’industrie du merchandising pour La Guerre des étoiles. Le magasin de jouets devient une succursale du cinéma et le supermarché, une usine à licences. Cela n’enlève rien aux qualités intrinsèques de la saga devenue culte, mais cette course aux profits écorne sévèrement l’image de grand enfant qu’entretient le metteur en scène.
A leur décharge, ces golden boys sont pris dans un tourbillon économique qui les dépasse et pensent sincèrement conserver leur âme d’artiste. En 1978, lors d’une conférence de presse à Londres, Spielberg déclare même à propos des Dents de la mer : « Je ne veux plus jamais travailler sur un autre film de ce genre. » Pas de suites, donc. « De vulgaires attrape-nigauds », ajoute-t-il quand on lui pose la question. Ne jamais dire: « Fontaine… » Le futur réalisateur de quatre Indiana Jones et de deux Jurassic Park tente plus ou moins de se tenir à son principe.

Daniel Goldman, qui distribua en France Les Dents de la mer, se souvient d’une discussion qu’il eut en 1980 avec Spielberg : « Il tournait Les Aventuriers de l’Arche perdue et me disait qu’il allait arrêter ces grosses machines et préparait un petit film intimiste. Il me parlait de… E.T. Après son triomphe aux Etats-Unis, nous avons dû repenser la stratégie de sortie ! » Chassez le naturel… N’empêche : malgré ses 792 millions de dollars de recettes mondiales, E.T. n’a jamais eu de suite. L’exception qui confirme la règle.
Car il y a belle lurette que le blockbuster à ouvert les vannes aux innombrables répliques et redites. Dans tous les genres, pour le meilleur et pour le pire. Quatre Arme fatale, cinq Die Hard, sept Fast and Furious, douze Star Trek… « Il y a bien quelques auteurs qui tentent d’imposer leur vision, mais ils représentent une minorité, constate Jean-Baptiste Thoret. John McTiernan (Piège de cristal) et James Cameron sont considérés parmi les auteurs les plus intéressants des années 1980-1990. Le blockbuster n’empêche donc pas la créativité. »
Et à condition que les studios, davantage à la recherche d’une martingale que d’un bon film, lâchent la bride au cinéaste. Ce qui n’arrive quasiment jamais. Et pour cause : les décideurs ne sont plus des nababs bouillonnants, mais des comptables pragmatiques. « Les types comme Jack Warner et Walt Disney n’existent plus, confirme Arnold Schwarzenegger. Les majors sont désormais entre les mains de patrons de chaînes de télé ou de multinationales, conseillés par des obsédés des chiffres, qui ne misent que sur du prévisible. »
Depuis une quinzaine d’années, le prévisible se nimbe de superpouvoirs. Batman, Spider-Man, Iron Man, Captain America… Et pour un Christopher Nolan qui met en scène le magnifique Dark Knight et un Sam Raimi qui s’amuse avec les premiers Spider-Man,combien de metteurs en scène interchangeables aux manettes de films sans âme, pleins de bruit, de fureur et de dollars?

Dans la majeure partie des cas, le blockbuster est désormais réduit à une trame simpliste, bons contre méchants, fabriquée pour un minimum de 150 millions de dollars. Les frais de campagne publicitaire doublent, voire triplent le coût, et il faut entre 600 et 800 millions de dollars de recettes mondiales pour amortir le mastodonte.
A ce tarif, les accidents industriels sont inévitables. En 2012, Walt Disney Productions essuie une perte sèche de 200 millions de dollars avec John Carter, et presque autant avec The Lone Ranger, sorti en 2013. « C’est la preuve que le système finira par se prendre les pieds dans le tapis », juge Jean-Baptiste Thoret. En mai 2013, Spielberg et Lucas eux-mêmes prédisent l’implosion de cette course folle à la démesure. Amusant…
Le fait est que les majors, obnubilées par les chiffres, privilégient l’offre à la demande. Et produisent des films dans lesquels l’arbre des effets spéciaux cache une forêt dramatiquement famélique et assez peu verdoyante. Il est vrai que les quelques fours n’ont pas de quoi les alarmer : toujours en 2012, Avengers, également dans le giron Walt Disney Productions, récolte 1,5 milliard de dollars ! Et cette année, Avengers 2 en a ramassé 1,1 milliard, tandis que Jurassic World, évidemment produit par Steven Spielberg et sorti il y a seulement deux semaines, en est déjà à près de 1 milliard. Alors…
« Moi, ça fait vingt ans que je réclame aux producteurs de financer les suites de Conan et de Jumeaux, s’exclame Arnold Schwarzenegger. J’ai eu gain de cause! Pour Conan, ils vont investir 150 millions de dollars, je vais me battre contre un méchant… Les gens vont adorer, c’est sûr ! » Et les financiers aussi, sans doute déjà en train de dessiner les courbes de bénéfices. A l’origine, Spielberg voulait que le dernier plan des Dents de la mer montre une bande d’ailerons de requins menaçant l’horizon. Métaphore prémonitoire d’un nouveau Nouvel Hollywood.
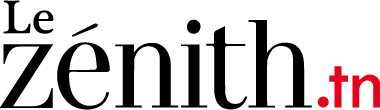 LeZenith.tn
LeZenith.tn


Vous devez être connecté pour poster un commentaire.