Le nouveau gouvernement et président tunisiens représentent des forces politiques qui ont émergé lors des élections de la fin 2019, suscitant populisme, polarisation et tensions. Avec le soutien judicieux de l’Union européenne, la nouvelle classe politique devrait se concentrer sur l’économie et choisir la voie du dialogue et de la réforme administrative.
Que se passe-t-il ? Les élections législatives et présidentielles de fin 2019 ont bouleversé la scène politique. Une nouvelle classe politique dite souverainiste a fait son apparition au parlement et à la présidence. Quatre mois ont été nécessaires pour que, le 27 février 2020, l’Assemblée octroie sa confiance à un nouveau gouvernement.
En quoi est-ce significatif ? La Tunisie a perdu un temps précieux. La présence de personnalités et de forces politiques dites souverainistes, favorise l’installation d’un climat de surenchère populiste augmentant les tensions politiques et la polarisation sociale et diminuant la capacité du pays à relever les défis économiques et sécuritaires.
Comment agir ? Afin de réduire ces surenchères, la nouvelle classe politique devrait faciliter la mise en place de mécanismes de dialogues inclusifs qui fixeraient de manière consensuelle les orientations stratégiques nationales de long terme, en particulier celles visant à accroitre la souveraineté économique du pays.
I. SynthèseEn septembre et octobre 2019, les Tunisiens se sont rendus aux urnes, choisissant de changer la physionomie de la classe politique. De nouvelles personnalités et partis incarnant certaines attentes populaires qui ont émergé au cours de ces dernières années, sont arrivés sur le devant de la scène politique. Cette nouvelle classe politique se livre à des surenchères populistes qui accroissent les tensions politique, polarisent la société et réduisent la capacité du pays à faire face aux défis économiques et sécuritaires. Pour diminuer ces surenchères, elle devrait participer à la création de mécanismes de dialogue réunissant les principaux acteurs politiques, syndicaux, administratifs et associatifs. Ces mécanismes aideraient à définir de manière consensuelle les grands choix stratégiques nationaux de long terme, notamment, ceux visant à augmenter la souveraineté économique de la Tunisie.
La Tunisie a déjà perdu du temps. Pendant près de quatre mois, aucune coalition parlementaire capable de former un nouveau gouvernement ne s’est dégagée. Le 10 janvier, l’Assemblée présidée par le président du parti d’inspiration islamiste, An-Nahda, Rached Ghannouchi, a rejeté le cabinet de Habib Jemli, proposé par ce même parti. Comme la Constitution le stipule dans ce cas, le nouveau président de la République, Kaïs Saïed, a désigné un nouveau chef de gouvernement, Elyes Fakhfakh, membre d’Ettakatol, parti social-démocrate qui appartenait à l’alliance gouvernementale et parlementaire (troïka, composée des partis An-Nahda, Ettakatol et Congrès pour la république) constituée au cours des premières années qui ont suivi le départ du président Ben Ali (2011-2014) et emmenée par An-Nahda. Fakhfakh a formé une nouvelle équipe ministérielle qui a obtenu la confiance de l’Assemblée le 27 février 2020 avec 129 voix pour et 77 contre.
Le nouveau gouvernement ne devrait ni ignorer l’importante pression des bases militantes et des citoyens mobilisés sur le plan social et politique (notamment ceux qui ont plébiscité le président Saïed avec près de 73 pour cent des suffrages), ni chercher à apaiser momentanément leurs attentes par des mesures populistes (notamment l’emprisonnement de « corrompus » ou la rhétorique anti-occidentale).
De concert avec la présidence de la République et le parlement, il devrait faciliter la création d‘espaces de dialogue qui réuniraient un maximum d’acteurs de différents horizons politiques, sociaux et professionnels afin de parvenir à un compromis sur les grandes orientations stratégiques nationales de long terme. Cela permettrait d’atténuer les conflits idéologiques et de réduire les surenchères populistes qui risquent d’affaiblir la capacité du pays à faire face soit à un choc extérieur provoqué par la dégradation de la situation sécuritaire à l’échelle régionale, soit à la détérioration de ses équilibres macro-économiques.
Ces grandes orientations porteraient, par exemple, sur l’amélioration de la qualité des services publics dits de première ligne – santé et assistance sociale, éducation et transports. Elles pourraient traiter des outils les plus efficaces pour débloquer l’action publique dans le domaine économique (loi d’urgence socio-économique) et démanteler graduellement les réseaux clientélistes qui affaiblissent la chaine de commandement au sein des institutions et minent la confiance entre ces institutions et de larges franges de la population (par le biais d’une réforme des impôts et de la douane et l’intégration d’une partie du commerce informel dans l’économie formelle, notamment). Elles pourraient également se traduire par la création d’une Agence d’intelligence économique qui permettrait de prendre des décisions économiques nationales plus harmonisées, notamment en matière de prospective stratégique, d’ouverture sur de nouveaux marchés ou d’utilisation plus efficiente de l’aide internationale.
Afin de consolider la stabilité de la Tunisie, l’Union européenne, l’un des principaux partenaires du pays, devrait soutenir ces orientations, leur élaboration et leur mise en œuvre, et convaincre les créanciers internationaux – y compris le Fonds monétaire international (FMI) – d’en faire autant. Elle devrait aussi tirer profit de cette nouvelle configuration politique pour concentrer son assistance dans les domaines qu’elle soutient déjà, tels que la réforme de l’administration publique, la lutte antitrust et le développement des régions périphériques, mais que les forces dites souverainistes, enclines à critiquer les interventions étrangères, seront moins susceptibles d’assimiler à de l’ingérence.
II. La défense de la souveraineté nationale : un nouveau leitmotivLa thématique de la défense de la souveraineté nationale, qui a joué un rôle décisif dans l’émergence de nouvelles personnalités et partis politiques à l’issue du cycle électoral de fin 2019, est apparu en plusieurs étapes depuis 2013. Au cours de 2013, dans un contexte de reflux du « printemps arabe » à l’échelle régionale, de faible rendement économique et social de la troïka et de montée de la violence jihadiste, l’idée que l’affaiblissement de l’Etat sape la souveraineté du pays a gagné du terrain dans la société tunisienne. Cette idée se traduit alors par une certaine nostalgie pour l’ancien régime (1956-2011). La scène politique se polarise entre islamistes et anti-islamistes, les seconds accusant les premiers de « vendre le pays à leurs alliés du Golfe », de ne pas croire à la Tunisie mais plutôt à la « nation islamique » (oumma), et d’affaiblir ainsi l’Etat à dessein pour mieux le pénétrer et le détruire.
En 2016, alors que l’attrait du salafisme jihadiste diminue parmi la jeunesse des zones déshéritées, cette demande de renforcement de l’Etat et de réhabilitation de l’ancien régime, que Nida Tounes n’était pas parvenu à satisfaire en s’alliant avec An-Nahda fin 2014, gagne en popularité dans cette frange de la population. Un nombre important de ces jeunes disaient, en 2015, espérer que l’organisation de l’Etat islamique « vienne les délivrer », comme le déclarait l’un d’eux. Un an plus tard, ils expriment plutôt le sentiment que le pays a besoin d’un homme fort comme Ben Ali.
En 2017, les discours répandus tant au sein des catégories populaires que des classes plus aisées, convergent vers l’idée que l’Etat et ses services publics (santé, éducation, transports) se délitent et que les Tunisiens ne sont pas prêts pour la démocratie, surtout parlementaire, laquelle entrainerait la généralisation du clientélisme, de la corruption et de la misère sociale et profiterait seulement à des politiciens vénaux et opportunistes.
Plusieurs responsables politiques, notamment de Nida Tounes, ainsi que des hauts fonctionnaires, affirment que la Constitution de 2014 et le mode de scrutin proportionnel au plus fort fragmentent la scène politique. Selon eux, ces deux éléments seraient les principaux responsables de la généralisation de la corruption dans un pays marqué par une crise d’autorité généralisée. Ainsi, comme l’avait noté Crisis Group, ces responsables sont convaincus que la seule manière de sauver le pays serait de reconcentrer les énergies et les moyens d’action aux mains d’un pouvoir exécutif solide, homogène sur le plan idéologique et de renouer avec l’hyperprésidence.
Par ailleurs, à partir de la seconde moitié de 2016, la concordance entre, d’un côté, marasme économique et baisse du niveau de vie et, de l’autre, pression accrue, notamment du Fonds monétaire international (FMI) et de l’Union européenne, conduisent plusieurs forces politiques et syndicales à dénoncer les atteintes à la souveraineté économique du pays telles que l’austérité budgétaire prônée par le FMI ou la prétendue appropriation des ressources naturelles de la Tunisie par des compagnies étrangères. C’est notamment le discours de certains membres du parti islamiste radical Hizb ut-Tahrir, de proches de l’ex-troïka, de militants de base d’An-Nahda, de nostalgiques de l’ancien régime, d’activistes de centre gauche ou d’extrême gauche, de nationalistes arabes et de cadres de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT).
Enfin, durant la seconde moitié de 2018, le débat autour des questions de l’égalité hommes-femmes en matière d’héritage, de la dépénalisation de l’homosexualité et de l’abolition de la peine de mort, trois points d’attention identifiés par le rapport de la Commission des libertés individuelles et de l’égalité (Colibe) publié en juin 2018, a été fortement médiatisé dans la presse nationale et surtout internationale.
Les interventions des médias étrangers soutenant ces propositions engendrent notamment un mouvement de réaffirmation de la souveraineté sur le plan identitaire. Nombre de Tunisiens, la plupart sensibles aux discours des forces politiques d’opposition (nostalgiques de l’ancien régime ; « révolutionnaires » de 2011, de gauche ou islamistes), dénoncent les mesures en faveur de l’égalité hommes-femmes en matière d’héritage. Ils les perçoivent comme une tentative de la classe politique, de concert avec l’Occident – notamment la France et l’Union européenne – de changer le mode de vie des Tunisiens, et en particulier de détruire la cellule familiale, dernier espace de solidarité face au durcissement des conditions d’existence.
III. Kaïs Saïed ou la défense de la souveraineté du « peuple » et de la nationSaïed, principal représentant de cette nouvelle vague « souverainiste », s’est fait l’écho de ces préoccupations. Cette approche a porté ses fruits : en tête du premier tour de l’élection présidentielle anticipée du 15 septembre 2019 avec environ 18 pour cent des suffrages, il a quasiment été plébiscité au second tour, le 13 octobre 2019, avec près de 73 pour cent, soit plus de 2,7 millions de voix pour un taux de participation de près de 57 pour cent.
Des jeunes des quatre coins du pays ont peint spontanément son portrait. L’atmosphère politique semblait passer de la résignation à l’espoir.
Son élection a eu lieu dans un contexte de confusion politique. Pour nombre de jeunes Tunisiens, sa victoire a été vécue comme un soulagement. Des campagnes citoyennes de nettoyage des rues et de boycott de produits alimentaires, objet de spéculation de la part d’intermédiaires, se sont multipliées. Des jeunes des quatre coins du pays ont peint spontanément son portrait. L’atmosphère politique semblait passer de la résignation à l’espoir.
Saïed est devenu une figure médiatique après le départ de Ben Ali, en tant qu’expert constitutionnaliste. Il était présent lors des sit-in populaires de la Kasbah en janvier-février 2011. Il a pris position à plusieurs reprises pour le processus de justice transitionnelle. Ses discours insistent sur le respect de l’équité régionale par la force du droit et la lutte pour la redistribution régionale et locale du pouvoir central.
Néanmoins, son orientation idéologique est beaucoup moins claire. Ses compagnons de route se partagent principalement entre membres de la gauche islamique tunisienne, inspirée de penseurs iraniens de la révolution de 1979, et ex-dirigeants d’extrême gauche, fondateurs d’une sorte de club d’idées en 2011, le Front des forces de la Tunisie libre. Pour Saïed et ses partisans, le peuple dans son ensemble doit redevenir le principal acteur politique. Cette idée est clairement formulée dans son slogan de campagne, « le peuple veut », entendu lors des sit-in de la Kasbah et de la Kasbah II en janvier-février 2011. Pour beaucoup, son côté rigide et juridiste, sa diction méticuleuse en arabe classique et sa frugalité personnelle, illustrent le caractère légal rationnel et impersonnel des institutions, que les partis politiques auraient fait disparaître en investissant l’administration publique.
Le formalisme juridique de Saïed semble répondre à l’exigence populaire d’une application du principe d’égalité devant la loi, une égalité qui passe par la moralisation et la restauration de l’autorité publique, la stricte neutralité du pouvoir judiciaire et le démantèlement des réseaux de « passe-droit ». Il défend l’idée d’un rétablissement de services publics forts dans le domaine de l’éducation, de la santé et des transports, et cite en exemple la Tunisie des années 1960.
Saïed critique la Constitution et le régime parlementaire mixte qui en découle. D’après lui, la Constitution de 2014 et le mode de scrutin proportionnel qui en est le prolongement auraient perverti la volonté populaire au profit d’un cartel de partis politiques. Il réprouve ainsi le régime politique défini par cette Constitution. Il voue aux gémonies les organisations partisanes et propose la mise en place d’une nouvelle architecture institutionnelle et politique basée sur la démocratie locale et la révocabilité. Les « supporteurs » de Saïed, comme ces derniers se qualifient, se sont abstenus aux élections législatives du 6 octobre 2019, dont le taux de participation a difficilement dépassé les 40 pour cent, car celui-ci n’avait présenté ni parti politique ni liste indépendante.
Il a également fait campagne sur le thème de la promotion d’une certaine indépendance économique. Il a mis l’accent en particulier sur la lutte contre la corruption de l’élite et sur la redistribution du pouvoir politique aux catégories les plus lésées de la population, deux mesures qui permettraient au pays de mieux résister à la pression de l’étranger, notamment dans le domaine économique.
En outre, son apparence jugée intègre et austère renvoie l’image d’une certaine Tunisie frugale qui peut « se passer de l’argent des bailleurs de fonds et que personne ne peut acheter », comme le note un sociologue. La probité de Kaïs Saïed en témoigne : mode de vie simple, habitat dans un quartier populaire, tournée dans les cafés de l’intérieur du pays dans une voiture bon marché, refus de remboursement public des frais de campagne du premier tour qui s’élèveraient à moins de 4000 dinars (environ 1400 dollars).
Par ailleurs, les électeurs de Saïed sont nombreux à dénoncer le prétendu pillage des ressources naturelles et à souligner leur potentiel apport décisif à la lutte pour l’indépendance économique. Nombre de ses sympathisants, en partie de jeunes Tunisiens estimant qu’ils méritent une meilleure condition sociale (diplômés chômeurs par exemple), affirment que la Tunisie est riche en ressources naturelles. Ils expliquent qu’il est nécessaire, dans un premier temps, d’éradiquer la corruption en restaurant l’autorité de l’Etat. Selon eux, cela faciliterait l’obtention de l’indépendance réelle du pays face aux grandes puissances. Il ne resterait plus ensuite qu’à redistribuer librement les richesses pour qu’advienne la prospérité, ce qui sous-entend que l’Occident est un obstacle à cette prospérité.
Le discours de Kaïs Saïed défend également une certaine souveraineté sur le plan identitaire. La dimension arabo-musulmane de l’identité tunisienne serait selon lui menacée par des interventions étrangères en tout genre, y compris dans les espaces intimes. Saïed s’est notamment prononcé à plusieurs reprises pour la criminalisation de toute tentative de normalisation diplomatique avec l’Etat d’Israël. Il s’est opposé à l’abolition de la peine de mort et à l’égalité hommes-femmes en matière d’héritage et a également émis un avis mitigé sur la question de la dépénalisation de l’homosexualité, les trois points controversés du rapport de la Colibe.
IV. De nouvelles forces souverainistes dans un parlement fragmentéLe parlement issu des élections du 6 octobre 2019 est plus fragmenté que celui issu du scrutin de 2014. Les deux formations politiques arrivées en tête de l’élection législative de 2019, An-Nahda (54 sièges sur 217) et Qalb Tounes (38 sièges), n’ont pu constituer une coalition majoritaire à elles seules, à l’instar de celle formée par Nida Tounes (86 sièges en 2014) et An-Nahda (69 sièges en 2014) au début de la précédente mandature.
Si la coalition constituée en 2014 avait réduit la polarisation entre islamistes et anti-islamistes, elle n’a en revanche pas réussi à relever les défis socio-économiques et institutionnels de la transition. Cela a, par conséquent, ouvert la voie à des demandes de changement plus radicales, s’exprimant en particulier à travers l’attachement à une souveraineté nationale qui serait violée. Ainsi, d’une part, Nida Tounes et An-Nahda ont été victimes d’un vote sanction, en particulier le premier, perdant la quasi-totalité de ses députés (il n’obtient que 3 sièges). D’autre part, de nouvelles forces dites souverainistes ayant exploité sur le plan électoral ces demandes de changement composent désormais près de la moitié de la nouvelle Assemblée.
Une partie est présente au sein du cabinet d’Elyes Fakhfakh aux côtés d’An-Nahda et d’indépendants, dont certains sont proches politiquement du président de la République et du chef de gouvernement (Courant démocrate et Mouvement du peuple). Une autre est dans l’opposition (Coalition de la dignité et Parti destourien libre). La plupart, à l’instar de Saïed, récupèrent les revendications exprimées lors du soulèvement de 2010-2011 (lutte contre la corruption, emploi des jeunes, réduction des inégalités régionales de développement) tout en étant enclines à surenchérir sur la question du renforcement de l’Etat, de l’anti-corruption ou de la défense de la souveraineté nationale.
Une de ces nouvelles forces souverainistes est le Courant démocrate, qui est passé de trois sièges en 2014 à 22 sièges en 2019 et possède trois ministères dans le gouvernement Fakhfakh. Créé en 2013, il est dirigé par Mohamed Abbou, ministre de la Fonction publique. Cette formation est la première à avoir surfé sur la thématique populaire de la lutte contre la corruption et de la restauration d’un Etat fort, au nom des valeurs exprimées lors du soulèvement de 2010-2011. Depuis 2017, elle concilie respect des valeurs libérales (notamment sur la question de la démocratie, des droits humains et de l’égalité), avec la lutte pour le retour d’un « Etat fort et juste » et la stricte application de la loi pour les « corrompus ».
Une autre de ces forces est le Mouvement du peuple, qui passe de trois à quinze députés et occupe deux ministères dans le gouvernement Fakhfakh. De tendance nationaliste arabe, ce mouvement est un ancien membre du Front populaire (coalition de partis d’extrême gauche et nationalistes arabes, devenu parti politique en juillet 2019) et a été dirigé de 2011 à 2013 par Mohamed Brahmi, député assassiné en juillet 2013. Le parti se focalise particulièrement sur la thématique de la défense de la souveraineté économique et cultive un discours anti-occidental et surtout anti-normalisation avec l’Etat d’Israël. Une partie de cette formation considère An-Nahda comme son principal ennemi politique et idéologique. En janvier 2020, un député indépendant, proche de ce parti, a qualifié les binationaux de « bâtards » qui, en monopolisant les circuits de décision politique, mineraient la souveraineté de la Tunisie.
La Coalition de la dignité apparait également à l’Assemblée avec 21 sièges. Formée en février 2019, elle se compose de listes indépendantes emmenées notamment par d’anciens islamo-révolutionnaires, membres des Ligues de protection de la révolution (LPR) de 2011-2012, du reste du Congrès pour la république (CPR – réduit à quelques militants) et de deux petits partis islamistes. Son porte-parole, Seifeddine Makhlouf, par ailleurs l’un des principaux avocats des salafistes-jihadistes tunisiens, s’est rendu célèbre par ses attaques répétées contre la France et son ambassadeur, qu’il accuse de piller les ressources naturelles de la Tunisie et de vouloir changer le mode de vie des Tunisiens.Il accuse également, de manière régulière, le bureau exécutif de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) de corruption. Il défend le port du voile intégral, s’oppose à toute forme de féminisme, mélange virilisme, anticolonialisme, anti-corruption, conservatisme et lutte contre l’élite économique établie.
Enfin, se revendiquant explicitement de l’héritage de l’ancien régime, le Parti destourien libre (PDL), dirigé par Abir Moussi (ancienne secrétaire générale adjointe chargée de la femme auprès du parti dissous de Ben Ali, le Rassemblement constitutionnel démocratique – RCD) fait également son entrée avec 17 députés. Sa présidente se prononce pour un régime présidentiel fort, attaque régulièrement la Constitution de 2014 et prône l’interdiction d’An-Nahda qu’elle décrit dans des termes similaires à ceux utilisés dans les années 1990 par les propagandistes du régime déchu (terrorisme, traitre à la nation, etc.). Depuis le début des travaux du nouveau parlement en décembre 2019, elle est engagée dans un « duel théâtral » avec An-Nahda et son président Rached Ghannouchi, ce qui contribue à repolariser la scène politique autour de la question de l’islamisme.
V. Les risques de cette nouvelle configuration politiqueL’émiettement de la scène politique, sa confusion et la méfiance réciproque des partis qui la composent comportent plusieurs risques. Ceux-ci expliquent en particulier la difficulté à former un nouveau gouvernement depuis le scrutin législatif d’octobre 2019. En effet, les alliances politiques se font et se défont, parfois à la dernière minute. Cette volatilité des alliances est due à plusieurs facteurs : le manque de confiance mutuelle qui augmente les tensions entre partis politiques et fragilise les négociations ; la polarisation islamistes/anti-islamistes alimentée par le regain de tensions régionales, notamment en Libye ; les surenchères idéologiques et politiques de la plupart des formations de taille moyenne qui demandent davantage de postes de ministres et de secrétaires d’Etat en échange de leur soutien le jour du vote.
Les dangers sont multiples. Le gouvernement d’Elyes Fakhfakh pourrait n’avoir d’autre choix que de gérer au jour le jour une situation économique qui se dégrade. Les conflits en son sein entre ministres indépendants plus ou moins proches politiquement du chef de l’Etat ou du chef de gouvernement, de ministres d’An-Nahda, ou de formations souverainistes – Courant démocrate et Mouvement du peuple – risquent d’être nombreux. L’opposition, composée en partie de forces également souverainistes – Coalition de la dignité et Parti destourien libre – sera encline à surenchérir politiquement (dénonciation de prétendues atteintes à la souveraineté nationale, accusation de corruption de personnalités politiques, déclarations pro-islamistes et anti-islamistes virulentes, etc.). Une atmosphère de polarisation de la société comparable à celle de la seconde moitié de 2013 pourrait s’installer de nouveau.
Le manque de rendement socio-économique du gouvernement pourrait, par ailleurs, le placer sous le coup d’une motion de censure du parlement et isoler Saïed, lequel ne dispose pas de formation politique. Sa capacité à satisfaire son électorat dépend, en grande partie, dans le cadre de la Constitution actuelle, des effets bénéfiques de la politique mise en place par le gouvernement. « Si celle-ci ne s’avère pas concluante, le chef de l’Etat en payerait le prix, nous passerions rapidement du rêve au cauchemar », note un dirigeant du Courant démocrate. La rancœur à l’égard de Saïed pourrait être proportionnelle à l’espoir qu’il a fait naître, ce qui pourrait pousser un certain nombre de ses supporteurs vers des formes de contestation éventuellement violentes.
En outre, la Tunisie a perdu du temps, et « au vu des défis économiques auxquelles elle est confrontée, le temps est ce qu’il y a de plus précieux pour le pays », note un diplomate européen. L’administration publique, en attente de nouveaux dirigeants politiques, fonctionne encore au ralenti. De plus, l’absence de nouveau gouvernement pendant près de quatre mois a rendu impossible la tenue des revues trimestrielles avec le FMI dans le cadre du plan 2016-2020. Le FMI n’a pu verser les dernières tranches du prêt, soit 1,2 milliard de dollars. Le pays risque de devoir renégocier un nouveau prêt et ainsi effectuer au préalable un certain nombre de réformes douloureuses allant de l’arrêt total des subventions publiques à l’énergie à la profonde restructuration des entreprises publiques.
Plusieurs économistes et hauts fonctionnaires affirment que sans ce prêt, la Tunisie est incapable de boucler son budget annuel. En attente d’un nouveau crédit, la Tunisie pourrait être contrainte d’emprunter sur le marché financier international à des taux d’intérêt très élevés, ce qui creuserait durablement son déficit. Cela engendrerait une nouvelle dépréciation de la monnaie nationale, un gel des salaires, des licenciements dans la fonction publique et une baisse du pouvoir d’achat ; une situation qui, à son tour, pourrait entraîner une montée de la criminalité et des tensions sociales.
Ainsi, le climat de surenchère populiste renforcé par l’austérité budgétaire pourrait encourager les autorités à apaiser les rancœurs de certaines franges de la population en menant des actions d’éclat, de répression et d’exclusion.
Ainsi, le climat de surenchère populiste renforcé par l’austérité budgétaire pourrait encourager les autorités à apaiser les rancœurs de certaines franges de la population en menant des actions d’éclat, de répression et d’exclusion. Par exemple, une nouvelle lutte sélective contre la corruption pourrait alimenter les tensions politiques, décourager les investisseurs et accroitre l’évasion de capitaux. De même, la tenue d’un discours anti-occidental et des cabales médiatiques visant, par exemple, les délégations de l’Union européenne et le FMI risqueraient de pousser le pays à se replier sur lui-même, ce qui mettrait en péril sa capacité à assurer le service de sa dette extérieure, sans pour autant améliorer ses performances économiques.
VI. Défendre la souveraineté nationale de manière pragmatiqueLa défense de la souveraineté de la Tunisie dans une optique populiste peut entrainer la polarisation de la scène politique, la déstabilisation des institutions et la défiance envers les bailleurs de fonds.
Néanmoins, dans le domaine essentiel qu’est l’économie, cette défense peut et doit se faire de manière pragmatique et inclusive dans une optique gagnant-gagnant entre les principaux acteurs politiques, syndicaux, administratifs et associatifs tunisiens, les pays partenaires de la Tunisie et les instances et organisations internationales.
A cette fin, le gouvernement d’Elyes Fakhfakh soutenu par la présidence de la République et le parlement devrait contribuer à mettre en place des mécanismes de dialogue élargis réunissant des représentants de partis politiques présents au parlement ou non, au sein du gouvernement ou dans l’opposition ; des élus (députés, maires) ; les directeurs généraux des administrations centrales ; les représentants de l’administration régionale et locale ; les représentants des corps professionnels ; les organisations syndicales, notamment l’UGTT et le syndicat patronal, l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat ainsi que les principales associations.
Ces mécanismes viseraient à produire des plateformes consensuelles sur les grandes orientations stratégiques nationales à long terme. Ils pourraient aider à canaliser les surenchères populistes en orientant une partie des controverses idéologiques que les forces politiques soulèvent, autour de choix constructifs.
Ces orientations stratégiques de portée nationale viseraient par exemple à accroitre la qualité des services publics dits de première ligne, comme la santé, l’assistance sociale, les transports publics et l’éducation. Elles tenteraient de trouver une solution durable au blocage de l’action publique dans le domaine économique, telle une loi d’urgence socio-économique permettant de contourner les lourdeurs administratives dans les secteurs pourvoyeurs de devises comme l’énergie.
Ces orientations pourraient aussi baliser un programme interministériel dans le domaine de la lutte contre la corruption. Ce programme s’attaquerait aux principales causes de la multiplication des réseaux clientélistes, laquelle contribue au blocage de la prise de décision et entraine la défiance de franges grandissantes de citoyens envers les institutions. Parmi les réformes envisageables, citons la réforme des impôts et de la douane, de l’administration et des entreprises publiques, ou bien encore l’intégration d’une partie du commerce informel dans l’économie formelle. En revanche, il serait bon d’éviter le déclenchement par les autorités d’une nouvelle « guerre contre la corruption », par nature sélective et populiste, comme Crisis Group l’avait noté dès 2017, et qui serait dommageable sur le plan économique.
Comme le préconisent certains experts, ces orientations pourraient également prévoir la mise en place d’une Agence d’intelligence économique combinant opérateurs publics et privés afin d’harmoniser les décisions économiques nationales : prospective stratégique, ouverture sur de nouveaux marchés, utilisation plus efficiente de l’aide internationale, etc.
Pour sa part, l’Union européenne, pourrait, d’un côté, soutenir ces orientations, de leur élaboration à leur mise en œuvre, et jouer un rôle de médiateur afin que les bailleurs de fonds internationaux, en particulier le FMI, lui emboitent le pas. De l’autre, elle pourrait adapter son assistance financière en se focalisant sur les domaines dans lesquels elle apporte déjà un certain soutien, mais que les forces politiques dites souverainistes sont moins enclines à associer à de l’ingérence étrangère, comme ce fut le cas avec la promotion de l’Accord de libre-échange complet et approfondi (ALECA) ou le soutien à l’égalité hommes-femmes dans l’héritage. Viennent à l’esprit notamment la réforme de l’administration publique, la lutte antitrust ainsi que l’aide au développement des régions périphériques.
VII. ConclusionTraduire les attentes populaires exprimées lors du dernier cycle électoral et éviter l’installation d’un climat de surenchères populistes durable diminuant la capacité du pays à faire face aux défis économiques et à réagir rapidement à la dégradation de son économie nationale ainsi qu’à un possible choc extérieur, est impératif. Pour ce faire, il importe d’œuvrer à accroitre la souveraineté économique de la Tunisie, conformément aux attentes populaires, tout en sauvegardant son intégration dans l’espace économique européen. Cette dynamique nécessite la mise en place de mécanismes de dialogue entre les principaux acteurs politiques, syndicaux, administratifs et associatifs tunisiens afin que ces derniers formulent des orientations stratégiques nationales de long terme.
Briefing N°73 / Middle East & North Africa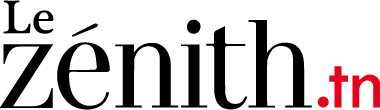 LeZenith.tn
LeZenith.tn





