Par Anis Basti
« Celui qui ne progresse pas chaque jour, recule chaque jour. » Cette citation empruntée à Confucius résume à elle seule la grande épopée de l’humanité à travers les époques. La figure de style anaphorique utilisée par le maître à penser chinois souligne la continuité temporelle de cette vertu qui n’en a cure ni du temps ni de l’origine. Tout ce qui se rapporte au vivant dans sa complexité est embarqué dans une sempiternelle spirale d’évolution. La sémantique n’a pas lésiné sur le répertoire pour le lester en corollaires de ce concept érigé en théorie. Progrès, amélioration, innovation, pour ne citer que ce triptyque, sont autant de vocables qui agrémentent un champ lexical en réalité beaucoup plus étoffé. Parfois une seule lettre accolée à un mot en produirait un autre qui lui est inhérent.
Les étymologistes sont les plus habilités à élucider cette convenance linguistique quand bien même elle est, à bien des égards, évidente pour certaines abstractions. La révolution n’est-elle pas une volonté délibérée d’évolution ? Un « R » en plus. Celle que nous avons connue sous nos cieux semble contredire la règle, car, tout compte fait, on marche à rebours de sa supposée vocation vertueuse. Une révolution est sensée apporter la prospérité et éveiller les consciences pour franchir le Rubicon en s’inscrivant mordicus dans la modernité et épouser ses normes en termes de citoyenneté et de sens du civisme.
Mais pour arriver à cet état de fait, le chemin se veut long et tortueux. Nul de sursaut civilisationnel sans un substrat de valeurs communes que porte tout un chacun en lui-même. Toutefois, pour y aboutir, il n’existe qu’une seule et unique issue qui est à même de maintenir la flamme de l’espoir vive : l’éducation.
À l’aube de l’indépendance, Bourguiba hérita d’une nation dont le taux d’analphabétisme frôlait les cimes. À l’exception de quelques privilégiés issus de la haute bourgeoisie, le reste de la population n’avait pas accès à l’école et semblait se résigner à son sort d’éternels parias livrés à l’ignorance et l’indigence intellectuelle. Le premier président de la République tunisienne fit de l’éducation son cheval de bataille pour asseoir un modèle de société inspiré des pays développés. Lui, qui voue une fascination ostensible pour Pierre Mendès France, anticolonialiste français notoire qui signa, entre autres, l’autonomie de la Tunisie et Mustapha Kamel Atatürk, fondateur de la Turquie laïque, était convaincu que le basculement d’une société viscéralement tribale vers une république où tous les citoyens se valent en droits et devoirs ne sera possible sans une politique de généralisation de l’enseignement urbi et orbi. Ce faisant, des écoles furent construites jusqu’à dans les bourgades les plus reculées pour braver la fatalité d’une vie cantonnée aux durs labeurs où l’accessit social n’est qu’un mirage réservé exclusivement à la bourgeoisie citadine. Bourguiba était persuadé que cela ne suffisait pas à convaincre des parents rétifs à la modernité, croyant à tort qu’elle allait bouleverser leurs fondamentaux et détruire leur mode de vie bucolique. Il rendit l’enseignement obligatoire à tout tunisien qui atteignit l’âge de six ans et exposa tout parent récalcitrant à des poursuites judiciaires. Mais simultanément à la coercition, le premier président de la République tunisienne ordonna la distribution, dans chaque école, de rations alimentaires pour associer le goût du savoir au besoin de se rassasier. Mais pas que. Les vaccins et les soins primaires furent également dispensés dans les enceintes des écoles à tous les élèves sans exception. Même l’art s’est invité au débat par la création de clubs de cinéma où l’on projetait puis débattait les productions cinématographiques du Box-Office de l’époque. L’école des années soixante avait dépassé son rôle strictement éducatif pour se transformer en véritable espace récréatif qui captivait les jeunes pousses au-delà de l’horaire scolaire conventionnel. Cette époque fut pour la Tunisie ce que les États-Unis connurent avec la génération Baby-Boom au lendemain de la seconde guerre mondiale. Une période faste qui fit éclore des éminences scientifiques, culturelles et artistiques mondialement reconnues. Cette effervescence que connut le pays, puise, de toute évidence, ses racines dans cette politique de scolarisation à tout bout de champ mais surtout dans une conviction collective partagée qui stipule que l’essor de cette jeune république ne deviendra possible que si l’on misait sur le développement humain à partir du moment où le sous-sol tunisien n’abonde pas de richesses. Une vision clairvoyante qui porta ses fruits pendant des décennies grâce, avant tout, à un système d’éducation complice de la qualité et de la performance comme l’attestaient les examens de fin d’études primaires – plus connu de sixième -, et du baccalauréat, qui furent de véritables travaux de Sisyphe ne récompensant que la fine fleur des disciples. Cette politique résolument sélective, fit gagner à la Tunisie la reconnaissance de ses diplômes à l’échelle internationale et servit de passeport aux étudiants tunisiens pour accéder aux universités les plus prestigieuses dans le monde.
Mais vers la fin des années 90 et le début des années 2000, le régime de l’époque changea complètement de stratégie, et opta pour une politique massivement diplômante au mépris du niveau des étudiants qui entama, inexorablement, sa descente aux enfers. L’examen du baccalauréat n’est plus que l’ombre de lui-même. Cette épreuve qui, autrefois, tenait en haleine aussi bien les élèves que leurs parents, ne suscite plus la même ferveur ni le même déchainement de passion qui en faisaient de cet examen l’Evénement d’une vie.
Aujourd’hui, tellement le bac a perdu de son lustre que l’on a tendance à l’assimiler à un simple passage de classe. Le nouveau système économique qui fait du capital sa clé de voûte, n’a, à vrai dire, pas arrangé les affaires. Décrocher un diplôme universitaire n’est plus une garantie pour jouir d’un statut socioprofessionnel décent. Nos universités sont devenues des machines à produire des diplômés chômeurs, dépourvus de toute perspective d’avenir, à qui le rêve le plus légitime de fonder une famille, n’est plus permis. Le sacro-saint ascenseur social qui donnait jadis droit au rêve, a subi un coup de massue entraînant la déconstruction programmée de la valeur du savoir dans l’imaginaire collectif des tunisiens. Le boom de l’enseignement privé n’est pas fortuit. La classe moyenne et moyenne-supérieure ne réfléchit plus à deux fois pour inscrire leurs progénitures dans les écoles privées quand bien même les frais de scolarité n’arrêtent pas de grimper. Des parents vont jusqu’à crouler sous les dettes pour offrir à leurs enfants un enseignement qui présente un seuil minimum de garanties non seulement par rapport à la qualité des cours dispensés, mais aussi pour l’assiduité, la discipline et la rigueur qui distinguent le secteur privé. Le phénomène s’est considérablement amplifié depuis la Révolution qui a, malheureusement, accéléré la décrépitude de l’enseignement public en l’enfonçant davantage dans ses travers. Entre une gestion publique qui laisse à désirer, l’insalubrité des établissements et tout récemment la prise en otage du secteur par des syndicats véreux aux revendications démesurées, l’enseignement public est parti en vrille et avec lui les espoirs d’une jeunesse désabusée, ayant nourri une aversion à l’ascension sociale par les bancs de l’école. Du pain bénit pour les réseaux criminels et filières de l’immigration clandestine qui ne peuvent que se frotter les mains de la flambée du décrochage scolaire et du désœuvrement d’une jeunesse livrée à elle-même.
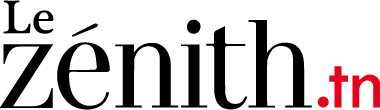 LeZenith.tn
LeZenith.tn





